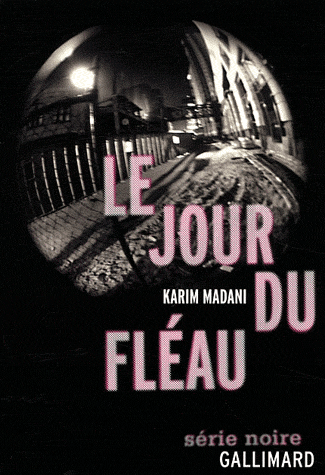
Critique du livre
Karim Madani - Le Jour du Fléau (2011)
le 02/05/2012 par olivier
Né en 1972 à Paris, Karim Madani est journaliste spécialisé dans les cultures urbaines et la musique afro-américaine. Déjà auteur de Fragments de cauchemar américain (2005), Hip-Hop connexion (2007), Les Damnés du Bitume (2008) et Cauchemar périphérique (2010), il publie en 2011 à la prestigieuse Série Noire (tiens donc…) un roman tout à fait digne de la collection: Le Jour du Fléau.
Peut-être est-ce dû à cette année 2011, dominée par la crise, les frasques de DSK, les inepties de Sarkozy, la découverte de la planète Kepler-22b, la fin du monde qui arrive (« ce sera pour l’année prochaine ») couplée à l’extinction définitive de l’analogique au profit du numérique et à la peur du nucléaire, je ne sais pas. Mais il doit y avoir eu quelque chose, un événement, un truc pas chouette, pour que Karim Madani donne naissance à un texte aussi noir, méchant, violent. Le Jour du Fléau prend place à Arkestra, cité imaginaire, « ville-léviathan », explique l’auteur, formée à partir des morceaux sales et dégénérés de Paris, New-York, Montréal, placée on ne sait où sur une carte qui, de toute façon, n’a plus de sens. On y rencontre Paco Rivera, ancien flic des stups muté aux moeurs après une sale affaire dans laquelle son indic et amante, Katia, a trouvé la mort. Depuis, Rivera est hanté par ce souvenir; dépressif, instable, il est devenu accro au Dinacode et croise sans cesse, dans les hallucinations que crée le sirop pour la toux, le fantôme de cette fille qu’il a aimée. Mais lorsque Pauline, une jeune adolescente issue des quartiers gentrifiés de la ville, est portée disparue, il va tout faire pour la retrouver avec sa coéquipière Gina, magnifique antillaise lesbienne, dans les dédales d’une ville dystopique, rongée par le vice, la violence et la corruption:
« Un ciel anormalement bas, qui chiait du plomb liquide sur les toits d’une ville gentrifiée. Une fin d’après-midi déliquescente. Avenue Euclide, dans les bas-fonds d’Arkestra, Les types qui avaient bâti cette Ville étaient des Protestants à la recherche de l’Arche de la Rédemption. Problème: ils avaient édifié leur temple sur un cimetière de païens dégénérés et adorateurs du Soleil. Ils avaient abruti les autochtones avec de la gnôle. Ceux qu’ils n’avaient pas réussi à convertir au Nouveau Paradigme, les réfractaires, connurent une fin brutale: alignés contre un mur et rectifiés. Avenue Euclide, dernier stop pour un coup tiré vite fait avec le diable, un fix, un caillou, une dose de Brown, un flingue avec numéro de série gratté à la lime, un contrat sur la tête d’une balance, une voiture volée, un tuyau sur la trajectoire d’une tirelire, une partouze satanique, un itinéraire bis pour une messe noire dans le quartier de Bliss. Arkestra, cinq circonscriptions, treize districts. Cinq raisons de conspuer le genre humain. » (p.12)
Le Jour du Fléau est un polar; une intrigue intéressante s’y développe, dans la glauquerie d’une société en phase terminale qui ne peut donner naissance qu’à des psychopathes: flic corrompu drogué au sucre, zombies crackés, tueur castrat, photographe voleur d’âme. Le lieutenant Rivera, qui n’est pas sans rappeler Harvey Keitel dans le chef-d’oeuvre de Ferrara, ne jure même pas trop avec tout ce petit monde dégénéré. Violent, instable, constamment drogué, il subsiste pourtant en lui quelque chose d’indicible, une lueur d’éthique, un désir de rédemption qui le pousse à chercher la Justice, même si elle ne semble plus exister. Est-ce à dire qu’il y aurait une forme d’espoir? Je n’en jurerais pas. Le Jour du Fléau est une descente aux Enfers dantesque, une plongée irréelle dans la noirceur et la violence d’une ville labyrinthe, semblable à une hydre qui pulse, organique et sans limites. Et c’est bien dans la construction de ce rapport entre un homme et la cité qui l’a vu naître que tout l’intérêt du roman se situe, plus que dans l’intrigue à proprement parler. Karim Madani écrit cette relation comme un morceau de rap, de jazz, de classique. Chacun de ces styles musicaux semble trouver son équivalent dans l’écriture même de Madani: le hip hop pour l’effet sampling, « percussif », rythmique et sec, le jazz pour les longs phrasés enlevés, les ruptures et l’aspect « free » de certains passages quasi-surréalistes, et enfin le classique moderne, avec son lyrisme et ses disharmonies. Bartòk est d’ailleurs présent dans le roman et accompagne constamment Rivera, entre réalité et hallucination, tout comme une pléthore d’autres artistes, contemporains ou non. Le Jour du Fléau est donc aussi un condensé de références, à la musique je l’ai dit, mais aussi à la littérature noire américaine et française, et au cinéma: il y a du Manchette (notamment La position du tireur couché, qui est par ailleurs un chef-d’oeuvre), du Ellroy bien sûr, du Goodis et du Burroughs, il y a du Ferrara, du Melville et du Clouzot, du Frank Miller et du Bob Kane, c’est-à-dire de la SF, du fantastique et du noir, tout ça oscillant toujours entre citation et appropriation. Indigestion de références? Un peu peut-être, mais c’est aussi ce qui fait que Madani parvient à créer un univers langagier fascinant et une mythologie urbaine particulièrement dense, qui nous renvoient à des choses lues, vues, écoutées, et surtout à lire, à voir, à écouter. En bref, on plonge dans ce roman et on n’en sort qu’à son terme, essoufflés, pleins d’images et de sons entremêlés, générés par une écriture à la foi personnelle et référentielle, qui mérite qu’on y prête attention lorsque sortira la suite prévue de ce qui formera un cycle, autour de cette ville-monde d’Arkestra à laquelle Madani a vraiment réussi a donner corps, profondeur et intensité.
« Le mercure était monté jusqu’à trente-cinq degrés, et les rues du ghetto d’Arkestra n’avaient pas tardé à se transformer en stand de tir. Un môme tatoué jusqu’à la moelle avec une balle de 9 mm fichée dans l’estomac couinait, tandis que deux infirmières tentaient de lui administrer un analgésique. L’hôpital Luthérien possédait une unité de chirurgie spécialisée, pour tout ce qui était blessures par balles. Les toubibs s’entraînaient ici avant d’aller soigner les nôtres en Afghanistan. Ils en voyaient de toutes les couleurs dans ce couloir, et de tous les diamètres: Beretta 9 mm, calibre 45, petit 22 chromé, 38 canon court, 11 virgule, Parabellum, 357 Magnum, Luger, Heckler & Koch, Glock, Scorpio, Tech-9, Mac-10. La litanie des balisticiens évoquait la géographie percussive d’Arkestra, des points de suture de l’Antre jusqu’aux nécroses de Bliss. […] Un jeune gangster juif, à peine majeur, criblé de balles, n’en avait plus pour très longtemps. […] Le gosse cligna des yeux, synagogues marmoréennes et pidgins mâtinés de cabale, fresques boursouflées et lignées de bandits frappés d’opprobre, alphabets empoisonnés. » (p.169-170)
Étiquettes : 2010-2019, Karim Madani, série noire
2 commentaires
Écrire un commentaire
© 2024 blog du peupl

Ca me rappelle furieusement mon enfance à la Vignettaz…
J’imagine… le deal de brown, les fusillades, les balles perdues…T’as vraiment dû en baver sévère!