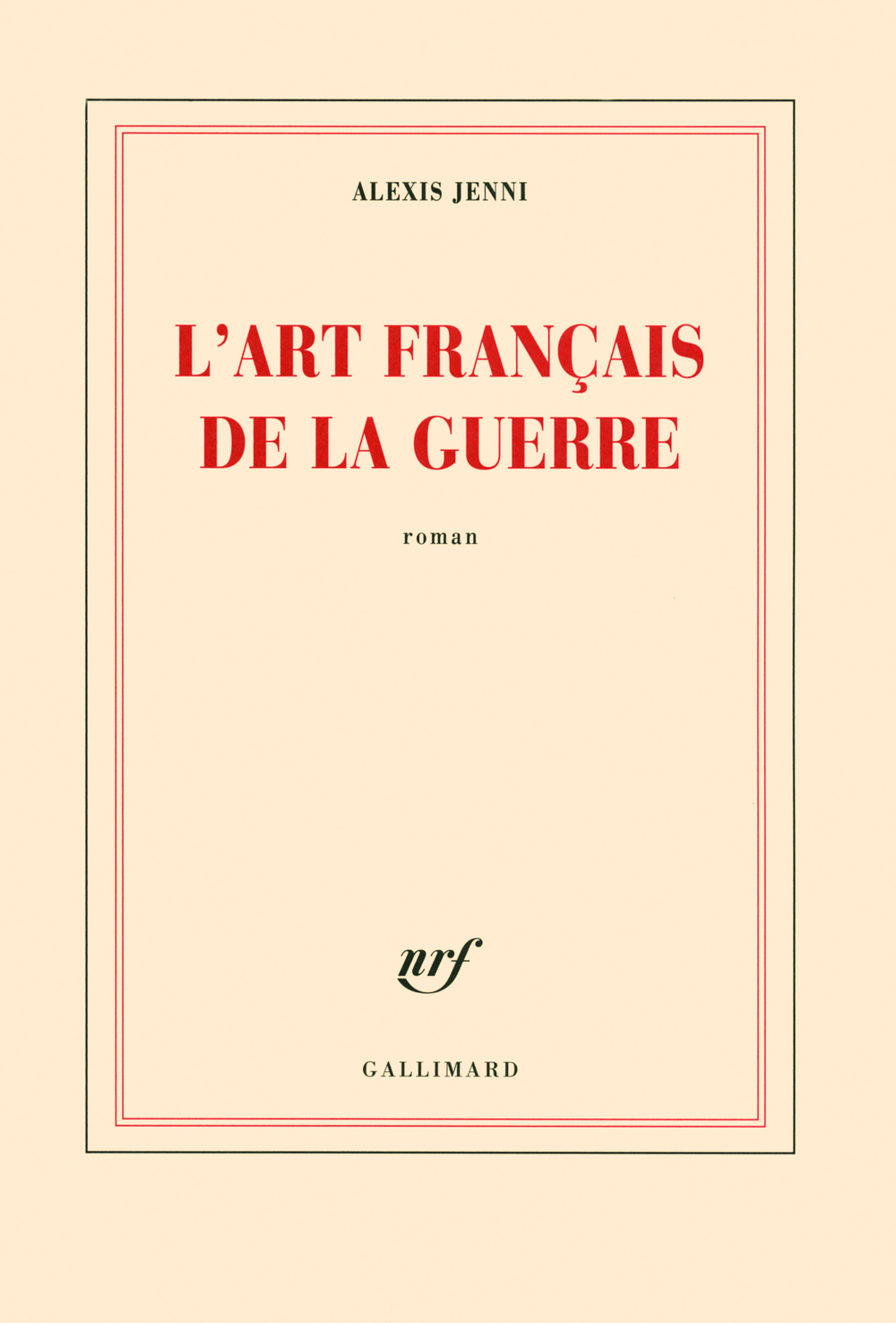
Critique du livre
Alexis Jenni - L'Art français de la guerre (2011)
le 23/05/2012 par thibaud
Parfait inconnu du monde littéraire jusqu’à la publication en 2011 de L’Art français de la guerre chez Gallimard, Alexis Jenni s’est vu attribuer le 2 novembre de la même année le plus prestigieux des prix français. L’Art français de la guerre est un pavé dont le titre académique évoque Le Testament français d’Andreï Makine, également récompensé par le Goncourt en 1995, ou encore plus récemment, Un roman français de Frédéric Beigbeder ayant reçu le prix Renaudot en 2009. Cependant, bien loin d’une vision fantasmée de la France ou d’un récit autobiographique, le roman de Jenni dresse quant à lui le portrait de l’épopée guerrière de la France au XXème siècle : l’échec de la Seconde Guerre mondiale, l’échec de l’Indochine et de la honteuse guerre d’Algérie. Des pages noires de l’histoire française sont confrontées ici à la situation politique contemporaine. Le récit des événements passés et présents révèle que « l’art français de la guerre […] ne change pas », en somme l’histoire répétée d’un échec, celui d’une idéologie de la force et de la race toujours d’actualité.
Le roman est constitué de treize chapitres répartis en « Commentaires » et en « Roman ». Les « Commentaires » forment le récit de la vie du narrateur, un homme dépressif et sans ambition vivant à Lyon, qui va rencontrer un beau jour Victor Salagnon, vétéran des trois guerres ayant peint durant toute sa vie. Les deux hommes font un marché : le narrateur accepte d’écrire les mémoires de Salagnon et en échange, ce dernier l’initie aux secrets de la peinture à l’encre de Chine. Les chapitres consacrés au « Roman » constituent le récit de vie de l’ancien militaire. Chaque témoignage de guerre (des Chantiers de la jeunesse française à la pratique de la torture en Algérie, en passant par les villages incendiés de l’Indochine) entre en écho avec des épisodes contemporains réels et fictifs, ayant eu lieu en France (l’émeute dans le métro parisien de mars 2007, l’émeute de Grenoble en juillet 2010, la mise en service d’une police militarisée comme réponse positive aux GAFFES, des militants d’extrême droite sévissant à Voracieux-les-Bredins, banlieue lyonnaise).
Les deux hommes sont reliés par deux éléments essentiels : la langue et la peinture. La langue est empreinte de l’idéologie à laquelle on ne peut échapper, l’idéologie de la force : « D’où vient-elle cette croyance en la vertu de la gifle ? D’où vient-elle donc cette idée qu’ « ils s’agitent » ? Et qu’ « il faut leur montrer » ; pour qu’ils se calment ». Mais aussi l’idéologie de la race et de la ressemblance : « La race est une pensée inconsistante, qui repose sur notre avidité éperdue de ressemblance ; et qui aspire à des justifications théoriques qu’elle ne trouvera pas, car elles n’existent pas ». La langue donc, porteuse des valeurs françaises, d’une identité nationale œuvre du grand « Romancier » de 58 qui usa de son talent dans « ses livres, et dans l’esprit même de ceux qui le lisaient. L’esprit des Français constitua l’œuvre du romancier : il les réécrivit, les Français furent son grand roman. On le lit encore. Il avait de l’esprit, qui est la façon française d’user du verbe, avec lui, et contre lui ». Jenni précise que « la réalité sera faite toute entière ce de qu’il aura dit » et qu’ « on eut avec lui de ces rapport peu connus qu’entretiennent les personnages d’un roman avec leur écrivain ». Ainsi, le peuple français apparaît comme le protagoniste du roman gaullien et le livre de Jenni comme la mise en abîme accusatrice d’une fable originelle, celle d’un grand F « emphatique, le F majuscule comme le prononçait de Gaulle, et maintenant comme plus personne n’ose le prononcer », un F dont « la grandeur emphatique du début empêche de moduler correctement le peuple de minuscules qui la suit ». Et Jenni de conclure : « Comment dire ? » lorsque la France « est une façon d’expirer ».
L’Art français de la guerre apparaît en cela militant, et la déclaration publique du nouveau Président de la République affirmant vouloir supprimer la notion de « race » de la Constitution française semble un écho saisissant aux accusations du roman (à croire qu’exorciser la langue des fantômes qui la hantent permettrait de se débarrasser, un peu, de l’héritage colonial ?) L’ouvrage porte clairement un regard critique sur la politique policière qui apparaît « après les élections » (2007), un sociologue rencontré dans la rue par le narrateur constatant : « L’appartenance ethnique est indéfinissable mais effective : elle ne peut se définir mais elle déclenche des actes qui sont mesurables. Les Arabes sont contrôlés huit fois plus, les Noirs quatre fois plus. Sans que personne ne soit arrêté d’ailleurs. Il ne s’agit que de contrôle ». Rappel des parachutistes fouillant les haïks à la recherche des bombes du FLN à Alger, un exemple parmi d’autres, illustrant le dialogue silencieux entre deux époques à l’œuvre dans le récit de Jenni. L’héritage idéologique de la politique coloniale apparaît sous la forme d’un éternel retour du même, l’auteur transposant les échecs passés des guerres d’Indochine et d’Algérie à la gestion sécuritaire du pays d’aujourd’hui : « Et maintenant, ici c’est là-bas ».
Le banquet de sang donné par le narrateur apparaît à lui seul comme la métaphore du projet du roman : derrière les apparences d’une société de consommation aseptisée (en l’occurrence, la description de la viande formatée d’un « hypermarché ») est révélé le tableau sanglant de la politique coloniale. L’exposition des mets sanguinolents (têtes de veau, tripailles, boudins, crêtes de coq, etc.) achetés au marché par un narrateur refusant « des cubes blistés de polyuréthane » et faisant fuir des invités au bord de la nausée, apparaît comme la volonté de mettre à jour, de déterrer les cadavres du cimetière sur lequel la politique française a voulu construire l’idée de nation. Ce cimetière situé sous les immeubles d’une banlieue quelconque (Jenni parle « d’étagères » pour décrire les HLM), et que des gamins vont déterrer par inadvertance, répandant une odeur nauséabonde aux alentours, évoque une exhumation des origines de la misère à Voracieux-les-Bredins.
L’Art français de la guerre se veut également le récit d’une épopée sanglante, celle de L’Odyssée des soldats français, de leur impossible retour au pays. Ulysse au pays des morts, demandant « à Tirésias le devin comment ça finirait », se voit prédire que « cela finira : dix ans de guerre, dix ans d’aventures violentes pour rentrer, où ses compagnons mourront sans gloire un par un, et un massacre pour finir. Vingt ans d’un carnage auquel Ulysse seul survivra ». Vingt années de guerre pour la France, et Salagnon de poser la question à son oncle (un militaire des trois guerres) : « Tu penses que cela finira un jour ? » et la réponse d’affirmer une volonté d’expiation à laquelle le roman tout entier contribue : « Ulysse a mis vingt ans à rentrer chez lui. Vingt ans, c’est le temps habituel du remboursement d’une dette. Nous n’avons pas tout à fait fini ».
Enfin, la peinture est ce qui permet à Salagnon de survivre aux affres de la guerre, tout comme l’écriture permet au narrateur de dépasser une idéologie omniprésente au sein de la langue, « je ne voudrais que peindre, montrer du doigt en silence et que cela suffise. Cela ne suffit pas » : paradoxe du livre faisant un constat accablant de la situation française tout en le surmontant par l’acte même de son écriture. La littérature et la peinture deviennent dès lors la possibilité d’une résilience. Une idée exprimée lors de la scène de la contemplation d’un jardin recouvert de neige, fragile dans sa perfection idéale, « impossible à imiter », qui sera saccagé par les jeux du narrateur et de Salagnon : le roman apparaît alors comme le pinceau qui enlève à la toile blanche sa perfection pour mieux révéler la réalité du décor, le narrateur et Salagnon sont « deux pinceaux traversant le vide, laissant derrière eux deux traces de neige abîmée ». L’Art français de la guerre est cette peinture de l’engagement, une « fiction critique » (selon la notion de Dominique Viart) émergeant d’une écriture subtile et riche en métaphores souvent originales, une langue qui se veut renaissante et fédératrice, l’histoire d’une réconciliation : « Je veux continuer d’entendre parler, j’appréhende que ma langue ne s’éteigne, je veux l’entendre, je veux reconstituer ma langue abîmée, je veux la retrouver tout entière avec tous ceux qui vivent d’elle et la font vivre, car elle est le seul pays ». L’écriture jennienne expie « les morceaux pourris » datant de l’époque impériale ou le français « était la langue internationale de l’interrogatoire ».
Malgré un récit parfois répétitif dans son contenu, ostentatoire dans sa mécanique symbolique (un peu comme les Algériens de La Bataille d’Alger de Pontecorvo dont chaque portrait « indique ce qu’il convient de ressentir à leur apparition »), le roman d’Alexis Jenni semble avoir séduit par l’urgence de son propos. Ouvrage de synthèse qui se veut également un avertissement, L’Art français de la guerre démontre, s’il y’avait encore besoin de le faire, que la littérature française contemporaine sait se montrer responsable, et que, loin d’être en péril, a encore de nombreux combats à mener.
Étiquettes : 2010-2019, Alexis Jenni, Fiction, Prix Goncourt
Un commentaire
Écrire un commentaire
© 2026 blog du peupl

Et encore un article qui me donne envie de lire en français et des bouquins contemporains, top chouette! (même si Jenni est aussi le nom de mon boucher de dentiste!)
Le mec a l’air de savoir manier la langue… Excellents les extraits sur le F… et les « étagères »… J’en veu plus.
Cool que tu rejoignes les rangs du peuple, sans majuscule!