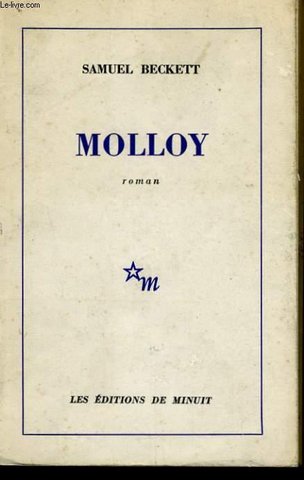
Critique du livre
Samuel Beckett - Molloy (1951)
le 26/09/2011 par lorrain
Molloy est au commissariat, et comme il peine à répondre aux questions de l’inspecteur quand il lui demande quel est son nom et si sa mère répond au même patronyme, on l’envoie dans un autre département :
« On ne faisait pas attention à moi et moi je le leur rendais bien. Alors comment pouvais-je savoir qu’ils ne faisaient pas attention à moi et comment pouvais-je le leur rendre puisqu’ils ne faisaient pas attention à moi ? Je ne sais pas. Je le savais et le leur rendais, un point c’est tout. Mais voilà que soudain devant moi surgit une grande et grosse femme vêtue de noir, de mauve plutôt. Je me demande encore aujourd’hui si ce n’était pas l’assistante sociale. Elle me tendait un bol plein d’un jus grisâtre qui devait être du thé vert sacchariné, lacté à la poudre, dans une soucoupe dépareillée. Ce n’était pas tout, car entre le bol et la soucoupe se dressait précairement une grande tranche de pain sec, dont je me suis à dire [sic], avec une sorte d’angoisse, Elle va tomber, elle va tomber, comme si cela avait de l’importance, qu’elle tombât ou non. Un instant plus tard moi-même je tenais, dans mes mains tremblantes, ce petit amas d’objets hétérogènes et branlants, où voisinaient le dur, le liquide et le mou, et sans comprendre comment le transfert venait de s’effectuer. Je vais vous dire une chose, quand les assistantes sociales vous offrent de quoi ne pas tourner de l’oeil, à titre gracieux, ce qui pour elles est une obsession, on a beau reculer, elles vous poursuivraient jusqu’aux confins de la terre, le vomitif à la main. Les salutistes ne valent guère mieux. Non, contre le geste charitable il n’existe pas de parade, à ma connaissance. On penche la tête, on tend ses mains toutes tremblantes et emmêlées et on dit merci, merci madame, merci ma bonne dame. A qui n’a rien il est interdit de ne pas aimer la merde. Le liquide débordait, le bol vacillait avec un bruit de dents qui claquent, ce n’était pas les miennes, je n’en avais pas, et le pain ruisselant se penchait de plus en plus. Jusqu’au moment où, comble de l’inquiétude, je jetai le tout loin de moi. Je ne le laissai pas tomber, non, mais d’une poussée convulsive des deux mains je l’envoyai s’écraser par terre, ou contre le mur, aussi loin de moi que mes forces le permettaient. Je ne dirai pas la suite, car je suis las de cet endroit et je veux aller ailleurs. »
C’est donc Molloy qui tient l’histoire entre ses mains, qui nous dirige où il veut et qui s’arrête quand il veut, mais qui est-il, que fait-il ? Lui-même ne le sait qu’à moitié. Parfois il sait, ou croit savoir, et l’instant d’après il oublie, ou change d’avis, se contredit… Il a l’idée d’aller voir sa mère. Voilà un objectif, qu’il garde sufisamment lointain pour pouvoir toujours le poursuivre ou en dévier. Son récit commence par ce qu’il appelle la fin, à savoir quand il aurait pris la place de sa mère dans un genre d’hospice : « Je couche dans son lit. Je fais dans son vase. J’ai pris sa place. Je dois lui ressembler de plus en plus. Il ne me manque plus qu’un fils. J’en ai un quelque part peut-être. Mais je ne crois pas. » Voilà où le texte débute; ce n’est pouratant pas là que le texte se termine, mais son histoire, qui sait… c’est possible.
Il part donc à la recherche de sa mère. Mais il ne sait pas où elle se trouve, ni même où il est, lui. Et s’il pense parfois à se renseigner, ce n’est qu’une pensée, voire un projet, mais de là à poser la question à quelqu’un… Ce personnage ne sait rien, il erre, il se laisse porter par les événements… Le narrateur est visiblement insensé, bizarre, fou. Le lire, c’est une expérience qui s’approche de l’art brut. Son regard sur ce qu’il appelle « l’autre monde », à savoir le monde extérieur, qu’il voit de son « seul oeil […] qui fonctionnât à peu près convenablement » est bouleversant. Il est parfois plus chien qu’être humain, parfois il tente de philosopher, monte des théories scientifiques où l’évidence devient abracadabrante. Il reste insaisissable, sans espoir et, avec cela, infiniment drôle. Molloy ne croit à rien, n’aspire pour ainsi dire à rien. Mais il pense. Et il écrit. En tous cas, le texte est là, absurde, profond… Les paradoxes se succèdent; le cynisme n’a pas de limite (voir plus haut, le passage sur la charité); les mots sont choisis avec le plus grand soin et avec souvent des décalages hilarants (comme un thé peut être désigné « le vomitif », sa mère s’appelle parfois « cette femme »; les gens changent de prénom au fil du texte). Molloy a connu le grand amour; il ne sait plus comment elle s’appelait; était-elle une femme ? Il émet des doutes sur tout. La moitié de ses phrases commencent par « mais », les autres finissent par « je crois ». Quand le mot vie coule de la plume de Molloy, il ne peut empêcher une réflexion sur l’emploi de ce terme : « A force d’appeler ça ma vie je vais finir par y croire. »
Peut-être que Molloy aspire à la circularité. Il désire retrouver sa mère; est-ce pour retourner là où il a commencé ? Dès la première page de son récit, il aimerait en finir et dit : « Moi je voudrais maintenant parler des choses qui me restent, faire mes adieux, finir de mourir. » Et plus loin : « si l’on voulait tout mentionner, on n’en finirait jamais, et tout est là, finir, en finir. » Sa vie semble un dur chemin vers la mort, un long chemin, tout sauf droit. D’ailleurs, Molloy sait que quand on veut aller tout droit on finit par tourner en rond, alors il tourne en rond, espérant ainsi aller tout droit… La vie de Molloy plonge en spirale vers le néant avec une sorte de satisfaction. Il perd des membres, et on lui en enlèverait un peu plus qu’il ne dirait pas non. Il régresse, se désagrège, oublie…
La première partie est un long paragraphe de 120 pages. Comme en finissant nombre de livres, arrivé à ce point je me dis que c’est le meilleur récit que j’aie jamais lu. Mais ce n’est pas fini. Il y a une seconde partie. Cette fois, celui qui raconte son histoire s’appele Jacques Moran. Il vit une existence bien plus humaine que Molloy, bien plus conventionnelle en tous cas, dans un monde d’habitudes et de certitudes. Et puis, un jour, son collègue vient lui apporter l’ordre de partir à la recherche de Molloy. Ah, voilà le lien. Et c’est pour lui le début de la fin, le début d’une quête initiatique ratée, vers la folie, le dépouillement, vers la mort, le non-humain, qui lui fait dire : « Je n’essaierai plus d’être un homme, je ne supporterai plus. »
Oui, le meilleur livre que j’aie lu, parmi beaucoup d’autres, mais maintenant, le meilleur. Et dire que c’est le premier que Beckett écrit dans sa langue d’adoption.
Étiquettes : 1950-1959, absurde, humour noir, Samuel Beckett
© 2026 blog du peupl
Écrire un commentaire